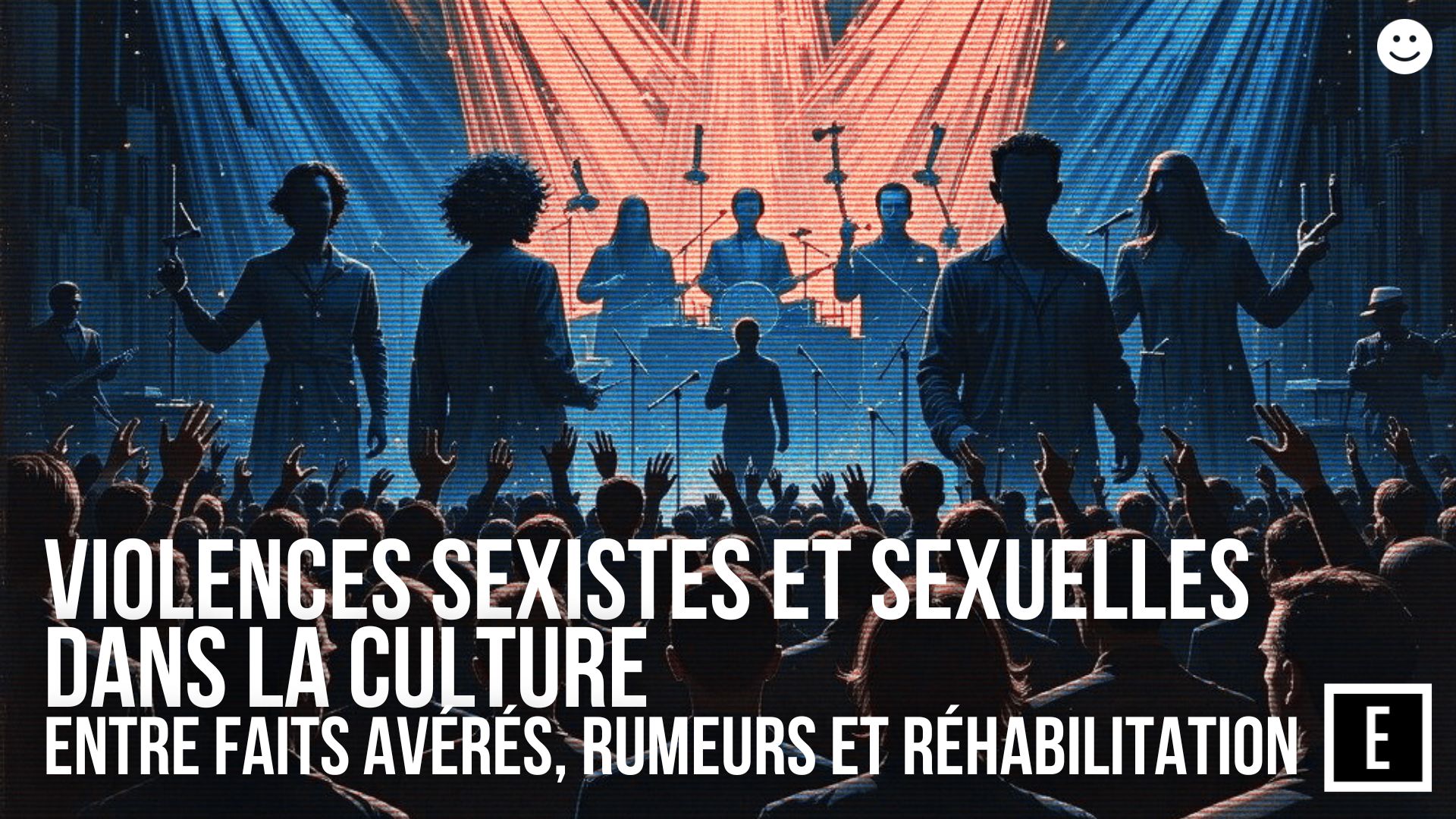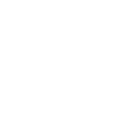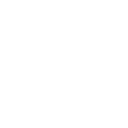Sexualité des jeunes : Entre méconnaissance, pression et pornographie
Entre méconnaissances, pressions sociales et omniprésence du porno, les jeunes de 12 à 24 ans naviguent dans une sexualité confuse, parfois violente, souvent mal accompagnée. Sur le terrain, je constate une génération paradoxalement plus exposée que jamais, mais moins équipée pour comprendre et vivre sa sexualité.
Une génération livrée à elle-même
Il y a trente ans, lorsque j’étais adolescent, on parlait sexualité à l’école, au collège, même avec les moyens du bord. On avait un cadre, des repères. Les médias, notamment la télévision, jouaient un rôle fort dans la lutte contre le sida, et la sexualité faisait partie des débats publics. Aujourd’hui, c’est redevenu tabou. Les jeunes sont extrêmement en retard par rapport à ma génération. Iels n’ont pas cette base. Selon un rapport de Santé Publique France (2023), seuls 15 % des adolescent·es déclarent avoir reçu une information satisfaisante sur la sexualité à l’école. Ce vide est comblé par Internet et les réseaux sociaux, souvent avec le porno comme unique source de « formation » sexuelle.
Le porno comme modèle, entre honte et norme
Pour beaucoup de jeunes, le porno est considéré comme la réalité. Cela concerne tout : les performances, les positions, le non-port du préservatif, la soumission des femmes, l’hyper-virilité des hommes. Et pourtant, iels ont honte d’en parler. Iels savent qu’iels s’y réfèrent, mais ne veulent pas l’admettre.
Le porno d’hier n’a plus aucun rapport avec celui d’aujourd’hui : du petit film de « boulle à papa » sur VHS caché sous le meuble TV, on est passé à l’âge d’internet et à sa face la plus dangereuse et la plus accessible. Environ 45 % de la toile est consacrée exclusivement à du contenu pornographique : vidéos, photos, blogs, sexshops… Plus récemment, on a vu débarquer la vague des OnlyFans, MYM et autres plateformes de « prostitution en télétravail », avec un nombre inquiétant de jeunes, parfois à la limite de l’âge légal.
En 2025, OnlyFans compte environ 3,5 millions de créateur·ices actif·ves dans le monde, dont environ 1,1 million aux États-Unis. La plateforme française MYM revendiquait déjà plus de 150 000 créateur·ices certifié·es en 2021. Ces plateformes permettent de partager du contenu en échange d’un abonnement mensuel.
D’après une étude de l’Ifop (2022), 82 % des garçons de 15 à 17 ans ont déjà visionné du contenu pornographique, contre 49 % des filles. Sur le terrain, je vois clairement cette influence : les garçons, surtout en groupe, parlent de sexualité avec humour, clichés et défis de performance. En tête-à-tête, c’est une autre histoire : j’observe de l’inquiétude, des contradictions, une méconnaissance flagrante des risques.
Les garçons redoutent souvent que l’acte sexuel ne soit pas à la hauteur de leurs attentes. Les filles, elles, expriment une peur plus relationnelle : tomber sur quelqu’un qui feint les sentiments pour coucher avec elles.
Le consentement, un mot mal incarné
Le mot « consentement » est connu, mais sa mise en œuvre concrète est loin d’être acquise. Les jeunes savent qu’il faut l’accord de l’autre, mais iels ont du mal à faire la part des choses entre ce qu’iels voient dans le porno, la vie réelle, et les limites personnelles de chacun·e.
Certaines pratiques, comme la fellation ou la sodomie, sont aujourd’hui évoquées sans tabou, comme des évidences. Mais ce sont aussi des pratiques de domination si elles ne sont pas librement choisies. Beaucoup de jeunes se laissent faire, car iels ressentent la pression du groupe, de l’image, de la norme.
Des risques invisibles, un choc émotionnel ignoré
Ce qui m’inquiète le plus, c’est l’absence totale de conscience émotionnelle autour de la sexualité. Le sexe est perçu comme une performance, un acte à accomplir, pas comme une relation. Une étude de l’Inserm de 2022 montre que 47 % des 15-24 ans déclarent ne pas se sentir bien informé·es sur les conséquences émotionnelles d’un rapport sexuel.
L’alcool reste un facteur classique de passage à l’acte. Mais aujourd’hui, on voit apparaître des drogues de synthèse. Cela ouvre la porte à la soumission chimique, volontaire ou involontaire.
Genre, orientation : entre tolérance affichée et violences ordinaires
Les jeunes semblent informé·es sur les questions de genre et d’orientation. Les coming-out sont plus fréquents, plus jeunes. Certain·es jeunes, autrefois marginalisé·es, assument aujourd’hui pleinement leur identité. Mais cette ouverture cache parfois d’autres formes de violences.
On assiste à une radicalisation progressive, avec des opinions de plus en plus clivées. Les religions, le communautarisme et un paquet de conneries télévisées sont passés par là. L’obscurantisme ne se laisse pas faire.
Dans les milieux festifs, les choses évoluent mieux. Les artistes LGBTQIA+ sont de plus en plus sollicité·es. Le monde de la culture a toujours été réceptif aux mouvements de société.
Le milieu festif : zone de risque ou opportunité ?
En milieu festif, nous utilisons tous les moyens possibles pour créer du lien. Cela nous permet d’aborder les sujets sans les imposer. On parle de sexualité, de violences sexistes, de parité. Chaque jeune est différent·e, et il faut s’adapter à elleux, pas l’inverse.
Iels ne sont pas responsables de leur éducation. Il faut leur donner les moyens de se comprendre, de se protéger, de mieux vivre leurs relations.
Certains festivals nous offrent une liberté totale, d’autres nous ferment la porte. Mais je suis convaincu·e qu’ils finiront par s’ouvrir. Pour d’autres, ce sera la fin, car qui ne s’adapte pas disparaît.
Réapprendre à parler de sexe, dès l’école
L’Éducation nationale et les parents ont, en grande partie, abandonné le sujet. Et je ne les blâme pas entièrement. Iels manquent souvent de soutien, d’outils, de convictions. Parfois, iels pensent que les enfants trouveront seuls les réponses. C’est une erreur colossale.
Les parents se retrouvent aujourd’hui dans une situation complexe lorsqu’il s’agit d’éduquer leurs enfants à la sexualité. En France, une grande partie d’entre elles refuse l’idée d’introduire cette éducation dès l’école primaire, avec près de 50 % qui sont contre un enseignement dès le CP. De plus, la majorité d’entre elles ignore ce qui est réellement abordé lors des séances scolaires, et plus de 60 % ne surveillent pas l’accès de leurs enfants à des contenus en ligne, laissant leurs jeunes face à des risques potentiels. Ce manque de suivi se traduit par un silence autour de la sexualité : plus de 40 % des adolescent·e·s n’en ont jamais parlé avec leurs parent·e·s, et celles et ceux qui s’y risquent se sentent souvent mal à l’aise. Ces chiffres montrent bien qu’il y a urgence à rétablir une communication ouverte et bienveillante entre parent·e·s et enfants, sans tabou, pour aborder ces sujets essentiels de manière saine et constructive.
On forme des individus pour le travail, mais pas des personnes bien avec elles-mêmes ou avec les autres. L’éducation sexuelle doit redevenir une priorité. À l’école, à la maison. Partout où cela peut être adapté.
L’éducation à la sexualité ne doit pas se limiter à la prévention des risques. Elle doit inclure l’émotionnel, l’affectif, le relationnel. Elle doit redonner une place à la parole, à l’écoute, au respect de soi et des autres. Parce que la sexualité n’est pas un danger, mais un terrain d’humanité.
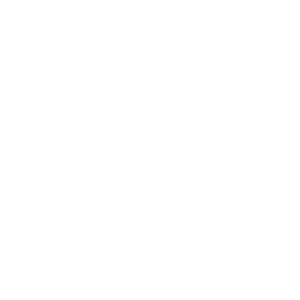
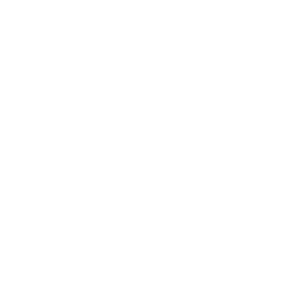
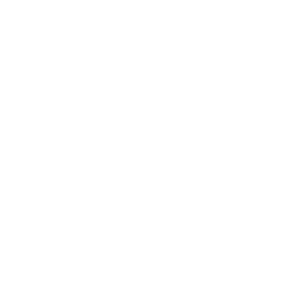
NEWSLETTER
Ne manquez rien d'Eclipshead, abonnez-vous à notre newsletter et recevez nos annonces, réflexions, événements et formations en avant-première.
Les derniers articles
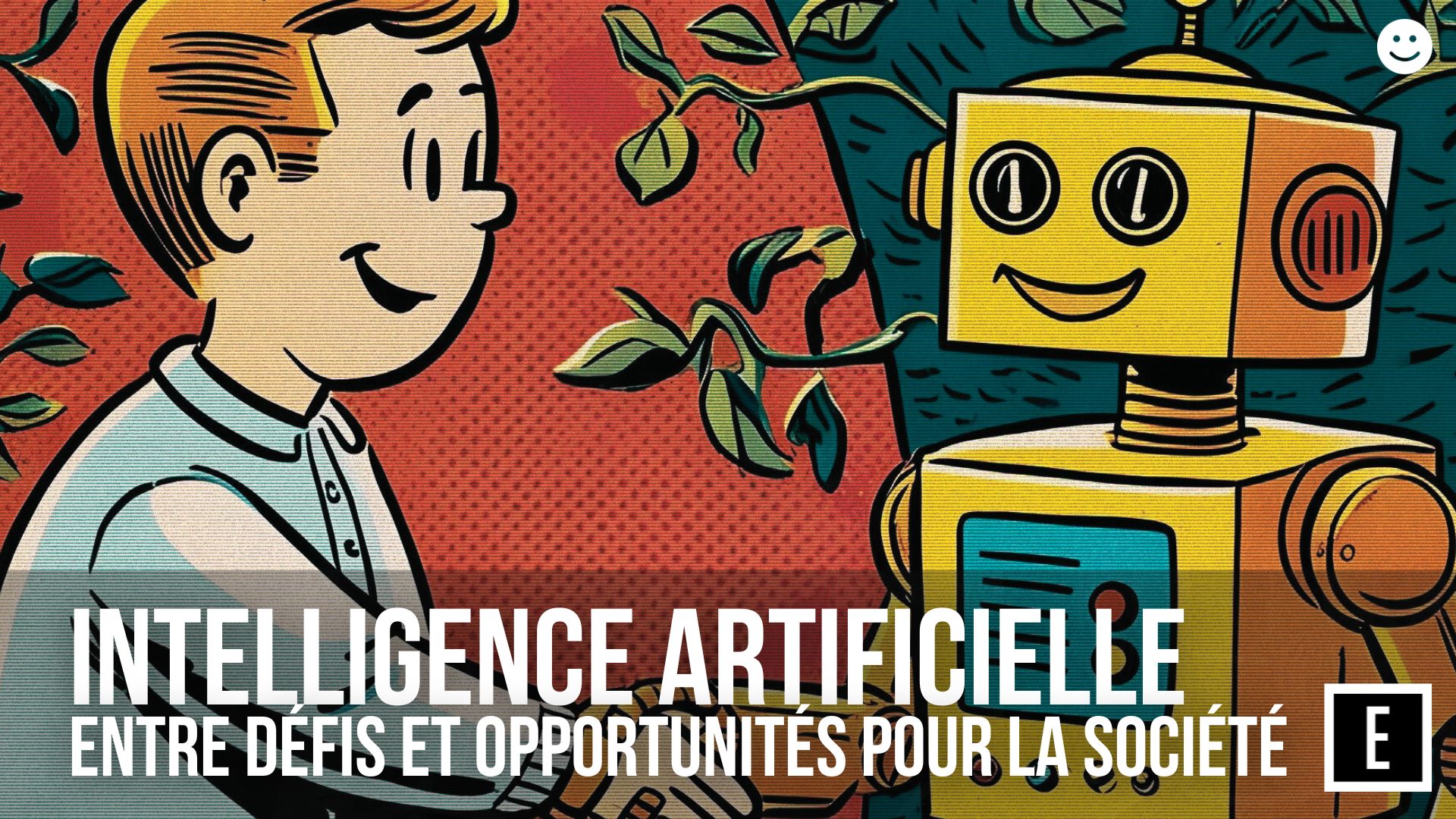
Intelligence Artificielle : Entre défis et opportunités pour la société
Catégorie : Réflexions
13 avril 2025

Sexualité des jeunes : Entre méconnaissance, pression et pornographie
Catégorie : Réflexions
9 avril 2025